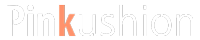Sur son quatrième opus, la new yorkaise s’émancipe du rock ombragé qui la couronna avec Tramp, pour une écriture plus classieuse et non moins habitée.
A l’instar de sa compatriote Marissa Nadler, Sharon Van Etten est certainement l’une des rares valeurs féminines du paysage folk/rock indépendant US à s’être imposée ces dernières années. Le parcours de cette native du New Jersey, songwriter et multi-instrumentiste, est d’autant plus notable qu’elle a traversé bien des galères depuis ses débuts discographiques en 2009. Après deux disques relativement passés inaperçus, son troisième, Tramp paru en 2012, qu’elle considère alors comme « celui de la dernière chance », profite enfin d’un bel engouement médiatique et critique. Il faut dire qu’elle est prise sous l’aile d’Aaron Dressner de The National qui produit l’album dans son studio et y assure même quelques parties de guitare royales (son frère Bryce aussi n’est jamais très loin lors des sessions d’enregistrement). La participation de Zach Condon de Beirut, invité à chanter sur l’irrésistible duo « We Are Fine », ne passe pas non plus inaperçue.
Ces collaborations auraient presque fait éclipser le talent de la principale intéressée. Ce serait pourtant négliger la beauté de ce disque rêche et électrique, où se distingue les harmonies vocales particulièrement sur la brèche de cette vocaliste d’exception – Il faut entendre les ravages émotionnels dont elle est capable avec la divine Julianna Barwick qui la seconde aux chÅ“urs sur deux titres. Car au-delà de cette longue liste d’invités sur les crédits, Tramp est une incontestable réussite et l’ opus le plus abouti à ce jour de la songwriter du label Jagjaguwar.
Consciente alors qu’on ne battit pas une carrière sur seulement des « featurings », la new yorkaise entend cette fois prendre les rênes de la production sur son quatrième album. Elle est assistée à la tâche par Stewart Lerman, vieux briscard multi-récompensé aux Grammys pour son travail jadis avec Elvis Costello – et plus récemment avec Sufjan Stevens et Antony and the Johnsons.
Cette montée en grade se ressent sur Are We There, un disque plus étoffé que ses productions précédentes. On peut même affirmer que Are We There bénéficie d’un budget qui doit certainement totaliser à lui seul les trois précédents opus de son l’Américaine. Mais Sharon Van Etten sait en faire bon usage la plupart du temps. Si la nervosité des guitares sur Tramp (le bouleversant « Give Out » résonne encore dans nos esgourdes), concède ainsi davantage de place à des compositions plus orientées « piano mélancolique », saupoudré d’une grande variété d’arrangements : Un orchestre de cordes, un orgue et même une section de cuivres (sur « Tarifa », belle ballade aux aspérités soul inédites pour la new yorkaise) justifient le budget. Les arrangements savent rester sobres, en retrait de la voix, à l’exception du puissant single « Your Love is Killing Me » qui a un peu la main lourde sur l’orgue épique, tandis que Van Etten y fait une impressionnante démonstration vocale. L’époustouflante technique vocale de Sharon Van Etten évoque parfois Florence & the machines, mais dénuée des dérives de la diva britannique aux motifs gothiques caricaturaux. On déplore aussi l’apparition d’une boite à rythmes et quelques touches electro dans la liste de ses nouveaux jouets – le très plat « Our Love » – un choix un peu trop facile et qui manque clairement encore de maîtrise.
Ceci dit, si l’album n’est pas exempt de défauts, il possède bien d’autres qualités. Ce ne sont pas tant les inflexions vocales de la new yorkaise qui nous touchent, mais plutôt lorsqu’elle se fait confidente et narre les écorchures de l’amour. Car il est bien sûr essentiellement question dans ses paroles de sentiments adultes, couchés avec une simplicité et une honnêteté qui nous touchent droit au cÅ“ur. Sous une approche de songwriting somme toute assez traditionnelle, cette voix se montre d’une proximité inouïe, frôlant parfois l’incantation tout en restant fragile (l’épure émouvante d’ »I Love You But I’m Lost »).
Are We There ne contient donc cette fois pas de duos, et c’est tant mieux. Mais la musicienne sait toujours très bien s’entourer. En témoigne ici lors des sessions la participation des membres de Shearwater, le touche-à-tout génial Adam Granduciel de War on Drugs (à la guitare sur deux morceaux, « Our Love » et le plus convaincant, « Everytime the sun comes up »), Peter Broderick d’Efterklang et Jana Hunter de Lower Dens, et pour finir, et non des moindres, le prodigieux Richard Swift au mixage sur cinq titres. Mais on le répète encore, nul besoin d’ouvrir le livret pour se laisser séduire par le talent de cette jeune femme vibrante et investie.